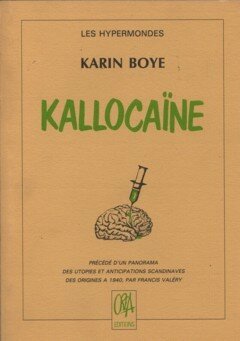Urgesat ! SF Page 2 : de l'anti-utopie
16.8.03
*************************


Karin Boye : « La kallocaïne »
Editions françaises :
1 : éditions Fortuny (1947) ;
2 : éditions Oréa (col. "Les Hypermondes", 1988) précédé d'un "panorama des utopies et anticipations scandinaves des origines à 1940" par Francis Valéry ;
3 : éditions Ombres (1988) avec une préface non signée.
Titre original : « Kallocaïn » (1940).
Traduit du suédois par Marguerite Gay et Gert de Mautort.
Karin Boye était suédoise. Elle a publié cinq romans et des recueils de poèmes. Très engagée politiquement à gauche, croyante en Dieu et en la psychanalyse, sa vie s’est pourtant mal terminée puisqu’elle s’est suicidée en 1941. Elle a cependant eu le temps de publier un roman peu connu encore aujourd’hui mais que je considère comme étant un chef d’oeuvre de l’anti-utopie : « la Kallocaïne ». L’influence de ce récit sur
« 1984 » de George Orwell me parait très probable.
En voici les grandes lignes. Dans le futur, l’Etat Mondial contrôle toute la vie de ses sujets. Les célibataires habitent dans un logement d’une pièce alors que les familles ont droit à deux. Les enfants restent avec leurs parents jusqu’à l’âge de sept ans, ensuite ils vont dans des camps et ne rentrent chez eux qu’une ou deux soirées par semaine. Chaque famille est de plus aidée par une « assistante familiale » qui s’occupe des enfants et qui change chaque semaine après avoir fait son rapport aux autorités. Dans chaque logement, un dispositif permet à la police d’espionner et de savoir ce qui se passe y compris dans la chambre à coucher. Peut-être faut-il y voir une des causes de la faible natalité de cette société ?
La vie est également rythmée par des services de surveillance policière à effectuer le soir après son travail et par des soirées consacrées à écouter des discours et à se former idéologiquement. En temps normal, deux soirées par semaine sont consacrées à la famille, une seule soirée par semaine en cas de crise.
L’ingénieur Léo Kall habite la « Ville de Chimistes n°4 ». Il est père de trois enfants et aime réellement sa femme Linda mais ne peut le lui montrer car l’amour véritable est très mal vu dans ce monde où l’Etat tente de monopoliser la loyauté de tous. Naturellement dénoncer quelqu’un y compris une personne de sa propre famille est un acte hautement citoyen dans ce paradis étatique.
Léo Kall vient d’inventer une sorte de sérum de vérité qui permettra enfin de débusquer les pensées mauvaises qui étaient jusqu’à présent inaccessibles à la police politique.
Après avoir été fort désappointé en constatant que finalement tout le monde a quelque chose à cacher et après avoir découvert une sorte de mouvement de résistance, il s’apercevra enfin de la perversité de l’Etat qu’il sert avec tant de zèle.
Linda est aussi un personnage très intéressant dans ce texte. Elle avoue à son mari lors d’une sorte de confession bouleversante qu’elle l’aime aussi sincèrement et qu’elle a beaucoup souffert lorsque leur premier enfant a du les quitter. Etant jeune, elle était loyale à l’Etat Mondial, croyait vraiment sa propagande et a eu des enfants pour en faire de braves petits soldats. Mais la maternité l’a changée, elle s’est mise à aimer ses enfants et elle a compris que l’Etat ne fera que les dévorer. Désormais elle veut trouver d’autres personnes qui comme elle sont devenues libres, au moins dans leur tête...
L’Etat Mondial finira mal et succombera sous les coups d’un de ses concurrents, l’Etat Universel qui n’a pas l’air de valoir beaucoup mieux. Grâce à son invention qu’il mettra volontiers au service de ses nouveaux maîtres, Léo aura la vie sauve mais il ne reverra jamais sa femme ni ses enfants.
Comme la plupart des anti-utopies, ce roman se termine mal. Il est vrai qu’en 1940 et 1941, il fallait être fait d’un bois particulier pour être optimiste.
Comme Zamiatine vingt ans plus tôt, Karin Boye connaissait bien le projet communiste et savait ce qui se passait en URSS mais vingt ans d’expérimentations communistes en plus, ce n’est pas rien. Il y a un saut qualitatif de l’anti-utopie entre ces deux textes.
Elle avait de plus sous les yeux l’Allemagne national-socialiste (Hitler prend le pouvoir en 1933) d’où provient peut-être l’une des idées de « la Kallocaïne » : la propagande officielle prétend en effet que les habitants des différents Etats se partageant la planète n’ont pas la même origine biologique et ne sont donc pas de la même espèce humaine...
A ce moment sombre de l’histoire de l’humanité, ce récit est le reflet parfait de ce qui pouvait se passer dans l’esprit de quelqu’un dont les idées socialistes avaient été cruellement déçues.
Contrairement à « Nous autres » et à « 1984 » dont l’action se situe après la victoire de la révolution socialiste, nous ne savons pas dans la « Kallocaïne » comment les choses en sont arrivées là. Je crois que Karin Boye avait déjà vu la profonde parenté qui unit tous les totalitarismes.
Ce roman malheureusement méconnu est exceptionnel. Il est moins littéraire (je pourrais dire moins surréaliste et moins poétique) mais plus élaboré que « Nous autres » car la « machinerie » totalitaire y est plus développée. Il est aussi plus terrifiant que « Le meilleur des mondes » (qui parait de nos jours, avouons-le, légèrement ridicule). S’il y a un roman vraiment précurseur à « 1984 », c’est celui-là.
Sylvain
Références :
- « Encyclopédie de l’Utopie, des Voyages Extraordinaires et de la Science Fiction » par Pierre Versins (éd. L’Age d’Homme, 1972), article « Karin Boye » page 127.
- « Science-Fiction : une histoire illustrée » par Dieter Wuckel (éd. Leipzig, 1988), page 158.
- Critique in revue "Fiction" n°400 (1988) par Pascal J. Thomas.
- « The Multimedia Encyclopedia of Science Fiction », CD-Rom, par Peter Nicholls et John Clute (Grolier, 1995).